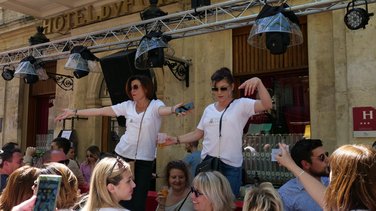GRAND AVIGNON Le Schéma de cohérence territoriale, pour se projeter sur vingt ans

Ce mardi, au siège du SMBVA, au Pontet (Vaucluse)
- Thierry AllardLe projet de révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de vie d’Avignon a été arrêté ce lundi. Une étape importante dans le processus d’élaboration d’un document qui l'est tout autant, puisqu’il vise à donner une vision au territoire pour les vingt ans à venir.
Porté par le Syndicat mixte du SCoT du bassin de vie d’Avignon (SMBVA), le document concerne bien plus que le Grand Avignon, puisqu’il s’étend « sur quatre EPCI (agglomérations et communautés de communes, ndlr) : le Grand Avignon, les Sorgues du Comtat, la Communauté de communes du Pays d’Orange en Provence et la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, soit 34 communes du Vaucluse et du Gard », présente la présidente du SMBVA, la maire de Villeneuve Pascale Bories.
Un territoire large donc, qui fait du SCoT du bassin de vie d’Avignon un des 21 schémas interrégionaux de France sur les 455 SCoT existants. Et ce périmètre a aussi été revu depuis la première mouture du document en 2011, en s’étendant vers le nord du Vaucluse tout en conservant les communes gardoises. « Il était donc important de le remettre à jour », avance Pascale Bories, surtout qu’entretemps, de nombreuses nouvelles lois sont entrées en vigueur, comme le zéro artificialisation nette, qui change nettement la donne quand on parle d’aménagement du territoire.
« Un vrai cap »
Trois ans de travail se sont engagés avec l’AURAV, l’Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, avec un but : « renforcer la co-construction du document », pose-t-elle, en associant les élus, membres du SMBVA ou non, le préfet de Vaucluse, les deux régions, le Département de Vaucluse, ou encore les personnes publiques associées, notamment les associations. L’idée est « que ce document soit rédigé par les élus, qu’il tienne compte des lois qui s’imposent à nous, mais qu’il définisse comment nous, élus, envisageons d’aménager le territoire avec ces nouvelles attentes législatives », affirme la présidente du syndicat mixte. « Ce document est une émanation de la volonté des élus », résume Christian Gros, président de la Communauté de communes des Sorgues du Comtat.
Pour ce faire, de nombreuses réunions se sont tenues, pour arriver à un document qui fait consensus entre 34 communes aux bords politiques parfois antagonistes. « Nous avons eu l’intelligence de nous asseoir sur nos divergences politiques pour travailler dans l’intérêt du territoire », se félicite le maire d’Althen-les-Paluds (Vaucluse) Michel Terrisse. Et, côté citoyens, six réunions publiques ont été organisées entre Gard et Vaucluse, nord et sud du territoire concerné. Ce lundi, le texte a été voté à l’unanimité, avec l’abstention de la commune de Morières-les-Avignon.
Un succès qui « ne s’est pas construit sur le plus petit dénominateur commun, souligne Gilles Périlhou, de l’AURAV. On a un vrai cap, une ambition, sur la transition écologique par exemple. » Le document est organisé en trois « défis ». Le premier est d’accueillir 33 000 habitants supplémentaires en vingt ans, avec le taux de croissance démographique de 0,5 % par an envisagé dans le document. Pour ce faire, il faut produire 28 300 logements, « pas forcément de la construction, aussi de la réhabilitation », pose Pascale Bories, notamment en réinvestissant les logements vacants, « c’est une priorité, un objectif fort », affirme Gilles Périlhou, certaines communes du territoire comptant parfois 10 % de logements vacants. Au passage, il faudra aussi créer 13 000 emplois, et travailler sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture, comme le train ou le vélo.
Le deuxième « défi » est environnemental, en protégeant le foncier agricole notamment. « La transition écologique est au centre du projet », résume Gilles Périlhou, notamment en protégeant les cours d’eau et en limitant l’imperméabilisation des sols. Le risque inondation sera également davantage pris en compte, comme la transition énergétique.
Investir les « dents creuses »
Troisième défi, peut-être le plus prégnant : le cadre de vie, notamment avec la loi zéro artificialisation nette (ZAN). Concrètement, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers va drastiquement baisser, et « il nous reste 620 hectares pour rester dans la trajectoire ZAN », explique Pascale Bories, et ce sur les vingt prochaines années. Pas grand chose, quand on sait que 1 140 hectares ont été consommés sur la période 2011-2020 sur le territoire. Alors « nous travaillons en priorité sur les dents creuses », poursuit-elle, pour moins consommer d’espace.
Pas question pour autant de faire pousser des tours de quinze étages dans les centres anciens : « il y a une volonté de réduire la consommation d’espace, tout en respectant la qualité architecturale de nos villes et villages », annonce la présidente du SMBVA. Pour y parvenir, le SCoT identifie un potentiel de 350 hectares d’espaces déjà artificialisés pour produire du logement et des équipements et un potentiel de 178 hectares sur des espaces déjà artificialisés pour créer de l’activité économique. « Il y a eu sur ce territoire un développement extensif pendant quarante ans, rappelle Gilles Périlhou. Nous pouvons donc profiter du gisement existant. En foncier brut, nous en avons sous la pédale pour la réutilisation. »
Désormais, il reste à lancer les consultations officielles des personnes publiques associées, ce qui ne devrait pas poser de difficulté majeure vu qu’elles ont « déjà été associées tout au long du projet », rappelle Pascale Bories. Puis l’enquête publique se tiendra probablement au dernier trimestre de 2025 pour répondre à un dernier défi : faire adopter ce texte début 2026, avant les élections municipales.