L'INTERVIEW Frédéric Fortin, à la ferme de la Noria (Robiac) : "L'agroécologie, ce n'est pas l'âge de pierre"

Frédéric Fortin, un jour d'installation de la micro-irrigation à la ferme de la Noria de Robiac-Rochessadoule
- François DesmeuresFormateurs, Frédéric Fortin et Arnaud Vens mettent en oeuvre des pratiques agroécologiques dans les jardins du Mas de Beaulieu, à Lablachère en Ardèche, que l'association Terre et Humanisme, inspirée par Pierre Rabhi, gère depuis 25 ans. Alors que celle-ci a repris la ferme de la Noria à Robiac-Rochessadoule, il y a deux ans, pour poursuivre la démonstration de l'adaptabilité de la pratique, les deux formateurs sortent un livre (chez Actes Sud), pour désacraliser la méthode et la rendre accessible à tous. Entretien.

Objectif Gard : Par quelles méthodes passe l'adaptation du "jardin nourricier au changement climatique", comme le propose votre ouvrage ?
Frédéric Fortin : Il n'y a pas une seule méthode, c'est vraiment multi-factoriel. C'est l'empilement de plusieurs méthodes compilées qui va faire qu'on va réussir à obtenir un jardin dans un écosystème équilibré, et surtout avec des ambiances de fraîcheur qui vont permettre de baisser la température l'été, garder le sol vivant et faire en sorte qu'il soit suffisamment sain pour donner à manger aux plantes, notamment pendant les fortes chaleurs.
Le réchauffement climatique est le principal objet de la lutte ?
Oui, le principal levier, c'est vraiment les canicules, les chaleurs extrêmes. Mais on parle aussi, dans le livre, des pluies qui s'intensifient fortement. Donc, comment faire pour que ces sols ne s'érodent pas, ne se lessivent pas, et qu'on garde un maximum d'eau dans les sols. Une autre facette du changement climatique, ce sont aussi les ravageurs qui viennent du sud. Plus il fait chaud, plus ils s'installent et trouvent des conditions idéales pour le faire. Donc, comment on s'adapte, aussi, à ces nouveaux ravageurs et à ces dérèglements climatiques ? Mais ce dont on parle le plus restent les extrêmes chaleurs, les canicules, qui sont une plaie terrible pour les légumes.
Les canicules nécessitent d'anticiper certaines productions
Que constatez-vous dans les sols, dans la réaction du végétal, depuis que les canicules sont plus fréquentes ?
Depuis 5 ans, on note vraiment une multiplication des canicules, comme partout. Et une difficulté des légumes à pousser, à croître sainement pendant les fortes chaleurs. Le pire du pire, ce sont vraiment les canicules précoces, comme en 2020 et 2022, en juin. Ce qui donne un problème de pollinisation, dans la croissance des plantes au niveau biologique, et des branches qui brûlent, par exemple, sur les pieds de tomate. Ça crée un dysfonctionnement biologique et hormonal au niveau de la plante, c'est ce qu'on a remarqué ces dernières années. Et aussi au niveau de la temporalité. Les pommes de terre, par exemple, les anciens ont toujours dit qu'on les plantait à la floraison du lilas. La floraison du lilas, c'est en ce moment. Mais si on met les patates en ce moment, on va vraiment avoir une petite production. Par contre, si on les met un ou deux mois en avance, début mars, elles auront des températures fraîches. On va donc avancer la saison, on mettra des voiles de production s'il fait froid, mais on aura une meilleure production. Et ça, c'est vrai pour la majorité des légumes feuille, comme les salades et les épinards.
"Ce livre est écrit par des jardiniers, pour des jardiniers"
Vous procédez à une adaptation permanente chaque année ou vous constatez que, ce qui a été mis en place il y a 25 ans, fonctionne ?
On empirise nos observations d'année en année, on s'est adapté. Du coup, on a vu que les légumes poussaient très mal au printemps bien installé. Les épinards, on s'est dit que ce n'était plus possible. Mais si on les met plus tôt en serre, et plus tôt dans la saison, on se rend compte qu'on a de beaux épinards. Pareil pour les betteraves, pour les choux, etc. Ce livre est écrit par des jardiniers, pour des jardiniers, et c'est notre retour d'expérience de 25 ans d'agroécologie, d'adaptation, etc. On s'est quand même adapté avec succès, ces dernières années : en 2022 - année charnière où on a décidé d'écrire le livre - on a eu 35 jours de canicule, ce qui est énorme. Pour un légume, c'est l'enfer. Mais aussi pour le jardin et le jardinier. Pourtant, cette année-là, on n'a pas changé grand-chose dans nos pratiques, avec des ombrières, de la biodiversité avec les haies, du paillage systématique, de la micro-irrigation sous paillage pour économiser l'eau et garder un sol frais, une recherche des essences... On a passé la saison assez facilement et, comme on note le moindre grain de production dans notre jardin, ça nous a permis de faire un bilan. Et, en 2022, non seulement on a réussi à maintenir la production, mais on a même atteint un record de production, malgré les 35 jours de canicule. Beaucoup de personnes nous ont demandé comment on avait fait, et Actes Sud nous a contactés pour savoir si on ne voulait pas faire un retour d'expérience.
"Une combinaison de pratiques ancestrales et de nouvelles technologies"
Vous avez partiellement répondu, mais est-ce qu'agroécologie et irrigation sont incompatibles ?
Pas du tout. J'ai l'habitude de dire que l'agroécologie, ce n'est pas l'âge de pierre. Ce sont des techniques pour travailler en collaboration avec le vivant. Mais aussi des techniques novatrices pour économiser l'eau : la micro-irrigation automatisée, ça permet de faire des économies très importantes. Au lieu d'un arrosage manuel au tuyau, aléatoire et chronophage, on apporte l'eau sous les paillages et les lancer la nuit, quand il n'y a pas d'évaporation, ce qui permet d'arroser au litre près. C'est une combinaison de pratiques ancestrales et de nouvelles technologies pour cultiver au mieux et travailler avec le vivant.
Vous parlez, dans le livre, de précipitations de plus en plus irrégulières, qui ne tombent plus forcément quand on les attend. Ceci ne devrait-il pas inciter à faire des réserves d'eau quand l'eau tombe ?
Oui. Vous ne parlez pas de méga-bassines ?
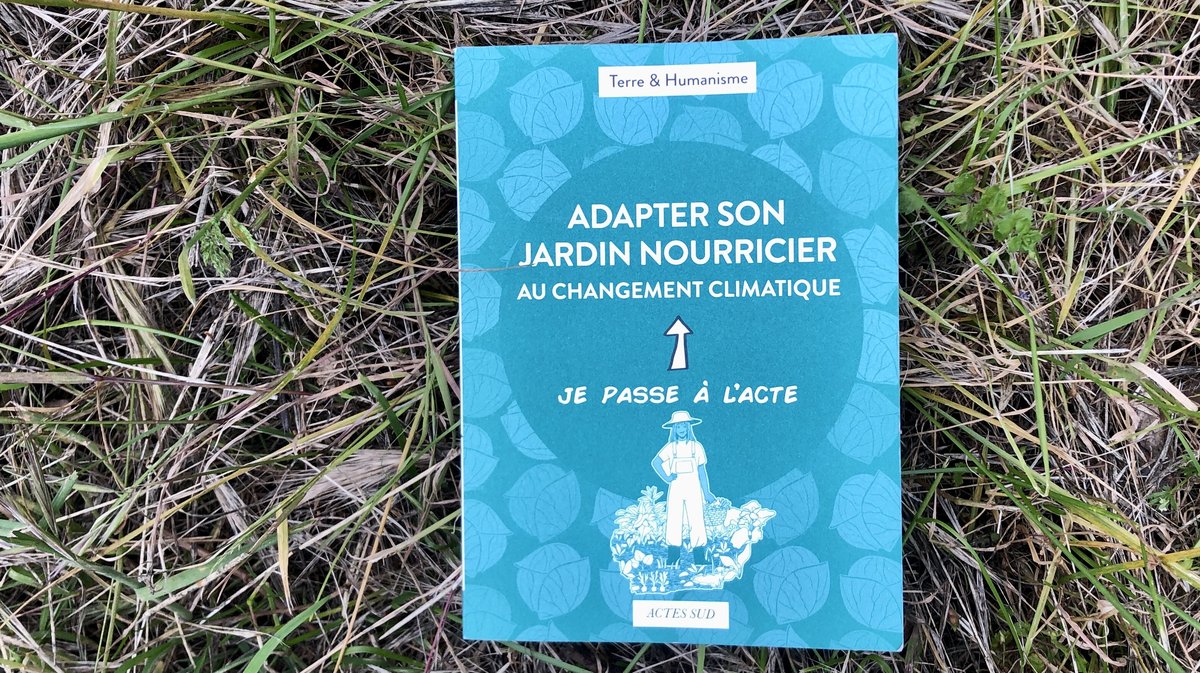
Dans les Cévennes, plutôt des retenues collinaires...
Au mas de Beaulieu, on a fait une réserve d'eau, de 480 m3. On récupère l'eau de pluie en hiver pour arroser l'été. Ce n'est que de l'eau de pluie qui provient des toitures. Ça a tout son sens parce que cette eau tombe sur des bâtiments, elle permet d'arroser une cinquantaine de légumes paysans et biologiques dans une démarche de formation pédagogique à l'agroécologie, ce qui va dans le sens des générations futures. Ce qui fait la différence avec les méga-bassines qui vont être utilisées par 1 ou 2 % des agriculteurs pour rester dans un ancien modèle d'agriculture conventionnelle de maïs ou autre, qui n'a plus de sens. D'autant que dans ce cas, l'eau provient de la nappe.
"toutes les techniques qu'on donne dans le livre, on peut les faire sur 4 m2"
Vous parlez aussi, dans le livre, de l'importance de la faune dans un potager. Pouvez-vous expliquer quel est son intérêt ?
On milite sur plusieurs piliers : un sol vivant, de sorte qu'il soit capable de donner à manger à la plante. Dans l'agriculture conventionnelle, on vient faire une perfusion de chimie dans un substrat, qui s'appelle le sol. En agroécologie, c'est tout l'inverse. On donne au sol de la matière organique, sa décomposition sera indirectement donnée à la plante. On va agrader les sols pour avoir, d'année en année, une meilleure porosité, une meilleure rétention d'eau, une meilleure rotation des minéraux. Le deuxième pilier, c'est de maximiser la biodiversité, qui va nous apporter mille et une améliorations de l'écosystème. Le premier conseil donné aux jardins amateurs, c'est de planter une haie immédiatement, sous les vents dominants. Elle va permettre de créer des ambiances l'été, d'infiltrer l'eau grâce à ses profondes racines, ce qui est notamment intéressant lors des épisodes cévenols. Et, après, ce sera le gîte et le couvert pour tous les auxiliaires, qui vont permettre de limiter la pression des ravageurs. La biodiversité est primordiale et va de pair avec le sol vivant. Tous les ans, on plante des fleurs, des arbres, on crée des refuges. Et ça fait baisser la pression des maladies.
Toutes ces préconisations, nécessitent-elles de disposer d'une surface minimale de potager pour que le cercle vertueux fonctionne ?
Non. Ce livre est vraiment dédié aux jardiniers. Et toutes les techniques qu'on donne dans le livre, on peut les faire sur 4 m² : le paillage, l'ombrière, le choix des essences, etc. Tout marchera sur un tout petit format. Et, d'ailleurs, si je peux donner un conseil aux débutants, c'est de commencer petit.
"On dit aux jardiniers qu'on n'est pas tout seul, on peut se mettre en réseau, qu'il y a des solutions"
Justement, vous incitez ceux qui voudraient mettre le pied à l'étrier à organiser des chantiers participatifs. Le principal écueil de l'agroécologie ne serait-il pas le manque de temps pour quelqu'un dont ce n'est pas l'activité première ?
Si. Mais c'est intéressant parce que l'agroécologie, ce sont aussi des techniques de fainéant, de paresseux. On va vraiment laisser le végétal travailler à notre place. On n'est plus dans le jardin de papy et mamie, à quatre pattes pour enlever ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes. En paillant, on s'évite ça. On ne travaille plus le sol à la bêche ou au motoculteur, on va juste l'aérer. On travaille avec le végétal et faire en sorte que le jardin soit un peu "bordélique".
C'est donc plutôt la mise en place qui prend du temps...
Voilà. Quand votre jardin est paillé, qu'il est en production avec un système d'irrigation, ça va tout seul.
Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, l'agroécologie permet-elle de rester optimiste ?
C'est une bonne question... Ce livre, on a vraiment voulu le faire de façon optimiste, même si on parle du dérèglement en début d'ouvrage. Mais on donne des solutions et on dit aux jardiniers qu'on n'est pas tout seul, on peut se mettre en réseau, qu'il y a des solutions, ce qui est optimiste.
Relire ici l'article au moment de la reprise de la Noria par Terre et Humanisme





























